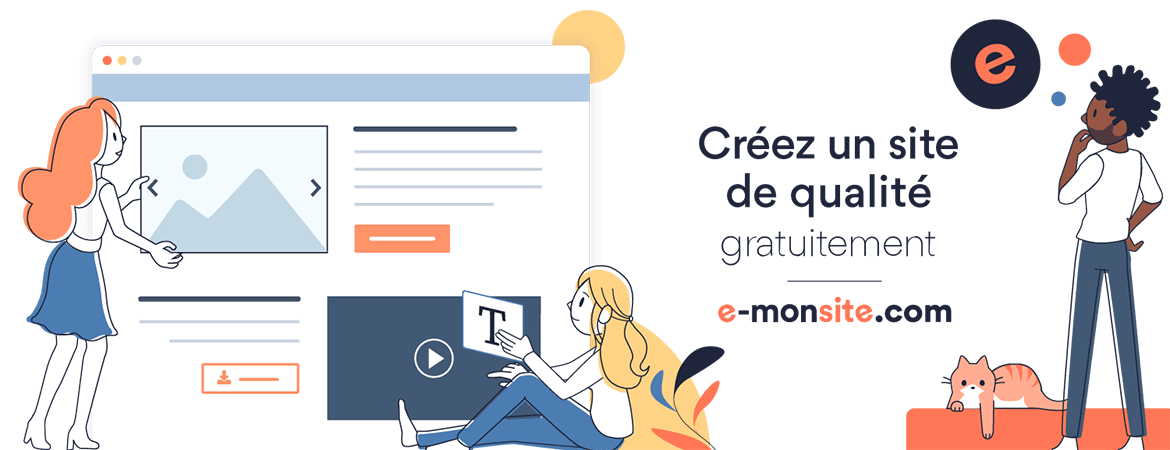- Accueil
- Articles
- Elites sociales
- Les seigneurs de la Vésubie (XIe - XVIIIe s.)
Les seigneurs de la Vésubie (XIe - XVIIIe s.)
Les seigneurs de la Vésubie (XIe - XVIIIe s.)
Les seigneurs de la Vésubie (XIe-XVIIIe siècles)
GILI Eric
Professeur d’Histoire Géographie au Collège de la Vésubie
Chandolent@gmail.com
En mémoire de Mado NEZIC (PERICHON)
Cet article est issu d’une conférence proposée dans le cadre de notre programme des « Samedis de l’AMONT », qui ont lieu une fois par mois à Roquebillière. Il s’agissait de proposer une vision diachronique du thème de la seigneurie sur le territoire de la Vésubie, considéré entre le XIe et le XVIIIe siècle. Il recouvre des natures et des aspects biens différents selon les points de vue que l’on adopte et les sources à notre disposition.
Afin d’avoir une vision un peu originale, adoptons un plan thématique plutôt que chronologique, qui permettra de mettre en évidence les trois formes qu’a revêtues la seigneurie dans la Vésubie : une forme laïque, une forme collective, et une forme ecclésiastique
Posons en préalable la question du type de seigneurie ?
La seigneurie laïque
Celle-ci est la première, chronologiquement, à apparaître dans notre vallée, mais nous ne la percevons qu’indirectement et incomplètement, malgré le travail fondateur de Jean-Pierre POLY, ou celui, remarquable par l’exhaustivité du traitement des sources écrites réalisé le Professeur Jean-Paul BOYER pour ce qui concerne le Moyen Age. Mais la seigneurie ne s’arrête pas à l’orée des temps modernes. Elle perdure, sous une forme différente bien évidemment, durant les XVIIe et XVIIIe siècles Politiquement comme structurellement, elle a connu de nombreuses transformations.
Définition
Il convient tout d’abord de proposer un petit rappel de ce qu’est la seigneurie dans notre imaginaire. Il s’agit de considérer un territoire, la seigneurie, dont la gestion se veut « rationnelle », divisée selon la répartition de ses terres mises en valeur soit directement soit indirectement par le seigneur.
Le premier mode de gestion, le faire-valoir direct, consistait à mettre, ou plus exactement faire mettre en valeur « directement » une partie de ce territoire, que nous qualifions parfois de « réserve », sous le contrôle attentif du seigneur. Pour cela, il disposait de plusieurs moyens : soit la corvée, la contrainte physique qui obligeait les paysans de sa seigneurie à lui devoir un certain nombre de journées de travail gratuites, soit la location de main-d’œuvre, elle-même abondante et parfois désœuvrée, ce qui arrangeait bien tout le monde. Généralement, ces deux modes d’exploitation étaient concomitants, et le seigneur complétait le bénéfice de la corvée par l’emploi de brassiers, manœuvriers, personnels qui obtenaient ainsi quelques monnaies.
Le faire-valoir indirect consistait à « chaser » des tenanciers, leur octroyer des terres de la seigneurie pour un temps long, une forme de location que nous appelons le bail emphytéotique, à 99 ans disent les juristes, renouvelable par tacite reconduction, mais dont la propriété éminente revenait au seigneur.
Les terres ainsi « cédées » aux paysans étaient appelées tenures, et donnaient lieu au versement d’un loyer annuel, que l’on appelait cens. Il pouvait être versé en nature ou en numéraire. Cette dernière forme était bien plus avantageuse pour les tenanciers car la monnaie a toujours eu tendance à se dévaluer, surtout en un temps où cette valeur était liée à son aloi, au poids réel de métal précieux que possède la pièce. Par contre, les versements en nature pouvaient devenir une charge insupportable lors des périodes de crises frumentaires.
Cette vision est en fait partiellement juste. Il s’agit surtout d’un modèle, admis pour généralité quasi-universelle, qui, bien entendu, ne peut être considéré comme un concept pratique transposable à l’ensemble de l’Europe. Son principal artisan, Georges DUBY, a été un grand maître pour des générations de médiévistes. Mais des aménagements ont été, depuis, apportés à son travail…
Tout d’abord, l’universalité du modèle a connu quelques variations, principalement en ce qui concerne la partie méridionale de la France.
Une seigneurie qui évolue
La seigneurie se doit de posséder un château, dont les représentations sont plutôt inspirées par les Riches Heures du duc de Berry que de la réalité révélée par l’archéologie. De plus, la destination de ce genre de structure, loin d’être limitée à une seule fonction défensive, explication que l’on avance généralement, l’est bien plus par la manifestation concrète du pouvoir qu’elle propose. Le château représente le pouvoir. Il l’identifie, lui donne une consistance visible et appréhendable par tous.
Cette évocation est d’autant plus pertinente dans notre région que le système castral semble avoir été précédé par un réseau de buttes castrales détenues par de petits seigneurs.
On constate la présence de castra (ce qui n’indique pas forcément la présence de véritables châteaux) dès le XIe siècle dans notre vallée . Mais, après la grande guerre de reconquête menée par le Sénéchal du Comte de Provence, mi-XIIIe siècle, il n’est plus question que d’un seul château, à Belvédère . L’enquête du Comte précise même que ce château doit être différencié d’une « tour » se situant à proximité.
Ainsi peut-on esquisser une géographie des castra et autres fortifications dans la Vésubie jusqu’à la fin du XIIIe siècle, mais nous ne pouvons aller plus loin à défaut de recherches archéologiques qui paraissent aujourd’hui seules capables d’apporter plus d’informations sur la période médiévale.
Le château, même s’il la symbolise, n’est pourtant pas la seule marque de la seigneurie. Le nom et la position du seigneur doivent également être considérés comme un élément d’étude, selon l’adage qu’il « n’y a pas de seigneurie sans seigneur ».
L’évolution de la noblesse locale est, elle aussi, indicative d’un vaste mouvement de transformations de natures sociale et économique que nous abordons sur plusieurs siècles.
Les premières familles seigneuriales
Des grandes familles de la « Première » noblesse, nous n’en avons que quelques traces au XIe siècle Pour notre région, les premières que nous connaissons sont celles de la famille ROSTAING de Thorame dès 1009 . C’est son petit-fils, ROSTAING RAINART qui, conjointement avec son épouse Adalaxia et leurs fils Feraud, Guillaume et Pierre, font d’importants « dons » aux différents monastères de Saint-Victor de Marseille, Saint-Honorat de Lérins ou encore à Saint-Pons de Nice.
En 1060 , ils donnent à cette dernière abbaye « un lieu alpestre et arrosable, bordé au nord par le vallon de Salèze, à l’est par la Vésubie (nous dirions le Boréon), et à l’ouest par le vallon qui semble être celui du Villar (Dalbazina) . Puis, en 1067, ils sont mentionnés dans cet acte fameux dont nous avons maintes fois parlé , de « restitution » des dîmes à l’évêque de Nice pour ce qui concerne l’ensemble de la seigneurie tenue par la famille ROSTAING, partant de Saint-Dalmas le Selvage jusqu’à Venanson.
C’est Guillaume ROSTAING qui hérite de la seigneurie de Valdeblore et sans doute d’Anduébis et de Venanson. Son fils, Hugues ROSTAING en prélève « le ¼ de la seigneurie » de ce dernier lieu, mais aussi « les hommes qu’il a à Saint-Dalmas et à Pedastas » lors de son entrée dans l’ordre canonial de Nice. Il s’agit d’une sorte de ‘patrimoine clérical’ avant l’heure, destiné à assurer des revenus confortables à son titulaire durant sa vie. Nous sommes alors au début du XIe siècle et le lignage est représenté par le frère du chanoine, Bertrand. Un important hiatus nous interdit de suivre la lignée durant tout le XIIe siècle Elle est toujours présente mi-XIII, mais semble moins prédominante qu’auparavant. Cette famille, à cette date, a perdu ses seigneuries et une grande partie de ses droits sur les villages de la Vésubie.
Une deuxième lignée apparaît en cette occasion. Il s’agit des seigneurs de VINTIMILLE. Si leur origine remonte également au XIe siècle , elle s’attribue des racines prestigieuses s’appuyant sur un corpus de légendes qu’elle fait remonter à Charlemagne. Si l’on en croit Emile ISNARD , ses possessions s’étendaient dès le XIe siècle aux « vallées de la Roya, de la Bévéra, Nervia, haute et moyenne vallée de la Vésubie, puis la Taggia ».
Il semble de plus en plus évident que les VINTIMILLE détenaient une part importante des droits seigneuriaux dans la Vésubie et particulièrement sur le village de Saint-Martin, où ils entrent en contact avec les ROSTAING, chacun sur une rive du Boréon.
L’histoire de cette famille est liée à la lutte perpétuelle entre deux puissances majeures voisines, celles des Comtes de Provence et de la République de Gênes. Mi-XIIIe siècle, leur pouvoir est en recul sensible. À l’Est, ils doivent céder la cité de Vintimille à Gênes (1251), puis, à l’Ouest, l’essentiel des terres qu’ils détenaient, dont le Val de Lantosque (1257). Seules les hautes Roya et Vermenagna sont finalement conservées, certains membres de la famille rejetant les concessions faites par les Comtes Guillaume et Boniface et décident de s’enfermer dans le réduit montagneux de part et d’autre du col de Tende. La fin du siècle est marquée par une série d’affrontements qui opposent la famille de VINTIMILLE aux Comtes de Provence. Après une reconnaissance forcée de leur vassalité en 1286, ils sont de nouveau en guerre contre le Comte de Provence au milieu du XIVe siècle, cherchant à assurer leur indépendance, jusqu’à ce qu’un nouvel hommage rendu au Comte de Provence vienne clôturer l’affrontement. Rappelons simplement, pour mémoire, le mariage du Comte de Vintimille avec la fille de l’empereur Byzantin, Eudoxie LASCARIS, en 1261, dont le nom, plus prestigieux, est relevé. Il leur donne une nouvelle légitimité au moment de l’indépendance.
Pour Charles-Alexandre FIGHIERA, les VINTIMILLE et les ROSTAING sont affiliés, parenté qui explique le caractère particulier que pris la chevauchée du Comte de Savoie alors qu’il vient d’obtenir les déditions des Communautés villageoises durassiennes de nos vallées. En 1388, Amédée VII ne passe ni par Tende, tenu par les VINTIMILLE, ni par le Valdeblore, tenu par BALD, descendant des ROSTAING. Ces familles soutiennent l’autre parti de la Guerre de l’Union d’Aix, celle-là même qui devait mener à la scission de la Provence orientale qui se donnait pour protecteur le Comte de Savoie.
Les indices et marques de cet important pouvoir dans l’espace ne sont plus visibles dans la Vésubie (le sont-elles ailleurs ? On peut penser au château détruit de Roure). Sur le terrain, seules quelques rares traces architecturales peuvent être décelées.
Le seul véritable vestige que l’on puisse attribuer à une fortification médiévale est celui du castro fortis de Loda. Ailleurs, il est probable que les ruines du Caïre del Mel correspondent au soubassement d’une tour. Jean-Claude POTEUR a également vu dans les soubassements de la chapelle Saint-André de Lantosque ceux d’une autre tour.
Enfin, quelques rares éléments que l’on peut considérer comme des fortifications de caractère urbain, à Utelle, Lantosque, Belvédère ou Saint-Martin-Vésubie. Mais rien de bien significatif.
Des indices peuvent être enfin décelés à Belvédère, où se trouvait le seul château comtal de la vallée , et peut-être encore autour de la chapelle de la Trinité de Saint-Martin, dont la structure et l’emplacement semblent indiquer une origine toute différente de sa nature actuelle.
Que conclure de ce premier épisode ? À l’évidence, que les seigneurs du « premier temps féodal », encore tout puissants au début du XIe siècle, voient leur pouvoir être concurrencé par de nouvelles puissances, dans un premier temps celle de l’Église, puis celle du Comte de Provence. Ces seigneurs des temps « féodaux », bien qu’ils aient dû céder au Comte la part la plus symbolique de leur droit de contrainte, la Haute Justice, dès le XIIIe siècle, conservent néanmoins de larges parts de leurs pouvoirs sur le territoire comme sur les habitants de la Vésubie jusqu’au milieu du siècle suivant.
Pourquoi cette particularité, alors même que la Tinée est solidement tenue par les ROSTAING puis les GRIMALDI, et que la Roya reste entre les mains des VINTIMILLE qui finissent par se replier sur la haute vallée, tenant le col de Tende ? Sans doute justement parce que la Vésubie se trouve dans une zone de contacts (une Marche, au sens premier du terme), entre les deux familles alliées et concurrentes. Cette situation est encore renforcée par la possession des deux cols donnant sur le Piémont qui pouvaient permettre au Comte de Provence de revenir dans le jeu géostratégique local, comme il l’avait fait quelques décennies plus tôt sur la côte. Pour mémoire, rappelons simplement que les milices qui partaient à la conquête du Piémont stationnent à Saint-Martin et y prêtaient serment au Comte, et ce, plusieurs fois durant cette période. Cette position engendra un intérêt particulier, dont le prix à payer a été lourd, celui d’une guerre qui fut selon toutes vraisemblances terrible si l’on se rappelle les deux indications données par Jean-Claude POTEUR : la première, celle de la disparition de 10 villages sur 17 connus avant 1252 ; la seconde, celle du remords qui porta le sénéchal de Provence, Romée, à demander un nombre conséquent de messes pour le repos de son âme, certaines étant justifiées, selon lui, par la destruction « sauvage » du castrum de Maïnonnas. Ce « village » aurait été situé entre Utelle et Lantosque. L’information apparaît dans l’enquête générale sur les droits du Comte au sujet de ce castrum (fuit dirrutum per Romeum ), dont les terres dépendent à cette époque du prieur de Gordolon.
La dissolution du pouvoir seigneurial
À l’époque où nous constatons l’installation et le dynamisme des Communautés d’habitants, les universitas, les grands lignages sont toujours présents. Leur pouvoir s’amenuise devant l’apparition et le renforcement de ce nouvel interlocuteur, très rapidement soutenu (peut être suscité ?) par le Comte qui trouve ainsi un moyen efficace de tenir entre ses mains ce territoire périphérique et stratégique. C’est parallèlement le temps où apparaît une nouvelle strate politique, celle que Jeau-Paul BOYER nomme les chevaliers. Celui-ci révèle leur présence dès 1140. En un temps où les noms de famille n’existent pas encore, les individus d’une certaine importance sociale et politique sont identifiés selon leur lieu d’origine : Lantosque, La Bollène, Utelle ou Loda…
Ces chevaliers ont laissé également quelques traces dans l’architecture locale, très modestes, mais qui ne laissent pas de doute quant à la nature du bâti qu’elles concernent. Il s’agit de croix de consécration, dont le meilleur exemple se trouve à Saint-Dalmas Valdeblore. Il semble en exister au moins une autre à Belvédère.
En fait, leur pouvoir se limite à la possession de quelques droits seigneuriaux, ceux de basse justice (les amendes dues pour empiètement de propriété, chapardage…) ou quelques revenus tirés de terres dites encore serviles (entendons sur lesquelles portent un cens, car il n’y a plus, à cette époque, de serf au sens médiéval du terme), qui suffisent à asseoir leur position sociale dominante, à l’échelle locale.
Ces petits seigneurs, même s’ils n’ont plus la puissance de leurs devanciers, possèdent une force de nuisance importante à l’encontre des Universitas (des villages) qui tentent alors d’établir leurs droits en se faisant reconnaître des « libertés ». Ces chevaliers cherchent encore à imposer l’usage exclusif de leurs fours et moulins à Saint-Martin au début du XIVe siècle . Ils sont déboutés de leurs prétentions par l’autorité comtale, mais leurs tentatives ne cessent pas pour autant. Nous pouvons dire, à la suite de Jean-Paul BOYER, qu’ils s’accrochent à leurs dernières prérogatives durant tout le siècle, quitte à revendiquer des droits infinitésimaux, comme à Loda, où Gilles TORNAFORTI réussit péniblement à racheter le 108e de la seigneurie au tout début du XIVe siècle.
Composition de la seigneurie médiévale laïque
Cette anecdote (le 108e d’une seigneurie) met en lumière l’état de décrépitude de la seigneurie laïque en Vésubie à la fin du Moyen Age. Elle a tout de même duré près de 400 ans durant lesquels cette forme de domination fut sans concurrence, ou quasiment. Quelles formes prenait-elle alors ?
Il s’agissait tout d’abord de dire la justice. À l’époque médiévale, on parle souvent de mère et mixte empire pour désigner la haute et la moyenne justice. La première concerne la peine capitale, celle que se sont attribués les seigneurs féodaux dans la phase de déchéance du pouvoir « central » (si tant est que l’on puisse alors parler de pouvoir central, il s’agit plutôt de celui des derniers carolingiens qui avaient cherché à restaurer l’autorité de l’Empire). La seconde concerne les actes de sang, qui peuvent entraîner d’importantes peines, dont celle de condamner au gibet. Et l’on se souvient qu’il existait à Lantosque un lieu-dit « des fourches » où l’on condamne encore à l’infamie au XVIIe siècle . Les actes de justice sont traités lors de plaids (certains auteurs attribuent au village de Rimplas le siège du Plaid carolingien - informations à prendre avec les réserves d’usage). Les seigneurs de VINTIMILLE de Tende siègent ainsi pendant 3 jours dans chaque village pour y dire la justice. C’est également ce droit de Justice qui est récupéré par le Comte de Provence, d’abord partiellement puis complètement dès le début du XIIIe siècle, quand il réussit à soumettre notre région. Le seigneur, selon son rang, pouvait encore prélever l’albergue (le droit de logement dans chacun de ses villages) et la cavalcade (en remplacement du service militaire dû par le vassal), droits qui ne pouvaient être perçus que par les plus importants d’entre eux.
L’essentiel des revenus de leur seigneurie porte sur des terres cédées en emphytéose, dont le loyer est payé en nature ou en monnaie, généralement à la saint Michel (29 septembre), au moment des grandes foires, quand on échangeait les surplus agricoles ou de l’élevage - rare moment de l’année où la monnaie circulait. Le cens, ou loyer, ne représentait bien souvent que quelques sous par an, ou permettait d’obtenir des revenus en nature, en sétier de seigle, ou de froment ce qui est plus rare, cette céréale étant plus fragile et n’était que peu cultivée. Quelques droits sont encore tirés des pâturages, que l’on devine à la fin du XIIe siècle comme des reliques d’une ancienne domination seigneuriale que le Comte grignote progressivement, récupérant ainsi des espaces qu’il estimait être régaliens. C’est le cas, par exemple de la fameuse Terre de Cour, vastes espaces d’alpages périphériques que les communes cherchaient à récupérer…
Les tenanciers doivent aussi payer des dîmes seigneuriales, comme celles remises entre les mains de ROSTAING par l’évêque de Nice en 1067. Mais plus généralement, et dès le XIIe siècle, des droits de mutation, comme le trézain (1/13e du prix de la terre vendue ou héritée, dû par le bénéficiaire lors du transfert de « propriété » effective), ou le droit de prélation, qui permet au seigneur de préempter une parcelle qui mute en offrant 5 sous en dessous du prix estimé « normal ». C’est ainsi que pouvaient se reconstituer des patrimoines seigneuriaux pulvérisés par les héritages et divisions successifs, et cela à moindre frais.
Ce furent enfin des droits de servitude, mais Jean-Paul BOYER les voit disparaître rapidement après la mi-XIIIe siècle, quand « 17 personnes semblent soumises à une taille ‘à merci’ ou ‘queste’ annuelle » , à Belvédère, symbole de leur assujettissement personnel à une autorité seigneuriale. Ou encore quand le même auteur révèle la présence d’un casamentum, un chasement, une terre sur laquelle est installée une personne servile… « attachée à la glèbe » comme on a pu le dire. Ce sont les derniers exemples qu’il a pu découvrir en Vésubie.
Au final, ce ne sont finalement que quelques parcelles de la justice que les seigneurs médiévaux réussissent à conserver, ou encore quelques droits portant sur des biens matériels. Fin XIIIe siècle, le Comte de Provence possède le domaine direct (c’est à dire la pleine et entière seigneurie) de toutes les communautés de la Vésubie, qui le reconnaissent comme leur souverain (c’est l’hommage-lige, ou majeur, que l’on prête au suzerain) en échange de la concession ou de la confirmation de leurs « libertés ». Celles-ci représentent le droit de s’administrer de manière générale, et plus particulièrement de dire la basse justice… Les Communautés villageoises sont alors devenues de véritables petites seigneuries collectives.
Retrouver les cartes sur le fichier pdf
La seigneurie des Universitas
Si on en devine l’existence de quelques-unes dès le XIIe siècle, la grande majorité des communautés d’habitants apparaît au siècle suivant. Elles sont appelées Universitas, ce qui indique clairement leurs revendications sinon à l’autonomie, du moins à la gestion directe de l’ensemble du territoire qu’elles dominent. Nous savons, grâce à Alain VENTURINI et Jean-Paul BOYER , que des consulats existaient déjà en 1163 à Tende et à La Brigue, en 1221 à Saorge, Breil, Limone et Vernante, en 1232 à Sospel, et sans doute avant 1290 à Saint-Martin et Venanson. Ces deux derniers sont confirmés après la reprise en main du Comte dans la Vésubie.
Comment les Universitas se sont-elles mises en place ?
Nous pensons que les habitants des agglomérations s’unirent face aux seigneurs féodaux en s’appuyant sur la fondation de confréries, formes d’associations jurées généralement placées sous le vocable et la protection du Saint-Esprit. Nous en retrouvons les traces dans la micro-toponymie des villages du Haut Pays, et particulièrement en Vésubie, où existent encore de nos jours des places du Saint-Esprit (à Belvédère) ou de la Frairie (Saint-Martin, Venanson, Roquebillière). Cette appellation provient de l’ancien nom de confraternitas, qui est à rapprocher d’universitas, la communauté d’habitants qui s’accordent pour se gérer collectivement. Le nom de Frairio rappelle donc les temps de la seigneurie collective des villages.
Les anciennes mairies étaient dénommées casa dal sant’ment ou du Saint-Esprit . Il s’agit là de nouveaux indices qui nous permettent de mieux comprendre la puissance de l’identification de la personnalité juridique et sociale de la communauté, qui doit faire face à celle du seigneur.
Leurs pouvoirs ont été tout d’abord partiels. Les universitas réussissent à s’approprier progressivement une partie des droits de contrainte du seigneur local sur les fours, les moulins puis d’autres biens à usage collectif et à forte valeur symbolique. Cette pression est tellement forte que les prétentions de la famille des VINTIMILLE sur ces droits sont rejetées en 1400 par la justice comtale face aux revendications des communautés villageoises. En fait, il s’agit d’une doléance récurrente puisqu’elle ressurgit encore à la fin du XVIIIe siècle quand la commune de Roquebillière, en 1764, doit encore ferrailler pour finalement réussir à racheter, pour 6 000 livres, les 4/5e du four « banal » jusqu’alors tenu par le baron GRIMALDI ; ou encore l’année suivante, quand le Comte Augustin LASCARIS décide de vendre les 10/13e du moulin qu’il détenait dans la même commune de Roquebillière. Celui-ci est finalement acquis pour 18 000 livres, somme colossale, qui plus est, grevée par la redevance qui pèse sur le bien et due au Comte GARAGNO . En fait, des parcelles de droits seigneuriaux subsistent durant toute l’époque Moderne.
C’est aussi le cas pour de vastes espaces du territoire revendiqués par la communauté, forêts et pâturages, qui, après avoir appartenus aux seigneurs féodaux, devenaient des biens collectifs. Mais avant d’être appropriés par les Communautés, ce fut entre les mains du Comte qu’ils échurent.
Devenue l’interlocutrice principale de l’autorité de plus en plus centrale, la Communauté renouvelle son allégeance à chaque succession de souverain. Elle maintient ainsi ses « libertés », ses droits de gestion locale, dans un rapport calqué sur le modèle des relations vassaliques. Ce véritable contrat place les villages sous la seigneurie directe du souverain. C’est d’ailleurs en argumentant autour de cette relation directe au souverain que les communautés villageoises cherchèrent à dénoncer les tentatives d’inféodation dont elles furent victimes à la fin du XVIIe siècle. Nous constatons d’ailleurs que les villages continuent à revendiquer la gestion directe de leur seigneurie (c’est-à-dire des biens communaux) à la fin du XVIIIe siècle quand ils demandent au souverain de renouveler leurs statuti campestri, sorte de codex local.
Il y a donc bien eu une réelle volonté de revendiquer et d’acquérir les prérogatives seigneuriales de la part des Communautés, et ce depuis leur fondation, en cherchant à conserver la mainmise sur les biens régaliens que furent, entre autres, les forêts et les pâturages.
En y regardant de plus près, la situation a pourtant évolué entre le XIIIe et le XVIIe siècle, en premier lieu en ce qui concerne les rapports entretenus avec le souverain. Celui-ci, tout en restant en rapport direct avec les communautés, met en place un échelon intermédiaire chargé d’assurer la continuité de leurs relations. Il s’agit de l’Intendant. À partir du XVIIIe siècle, et plus particulièrement après la grande réforme politique de 1775, qui limite le nombre de conseillers et donne plus de responsabilités aux syndics (l’équivalent des maires), le souverain rompt dans les faits le lien vassalique hérité du Moyen Age. Désormais, l’Intendant surveille la Communauté, vérifie ses comptes et introduit la notion de responsabilité personnelle des édiles devant ses services. Avec cette réforme, il en est véritablement terminé de la seigneurie des Universitas.
Après la dédition du Val de Lantosque de 1388, alors que s’établissait la seigneurie des Universitas, une nouvelle noblesse se met rapidement en place. Elle est formée de « créatures du comte puis du duc de Savoie, nouvelle noblesse recrutée surtout dans la classe des riches marchands et des magistrats » . Le dernier représentant de l’ancienne noblesse qui joua un rôle important fut le baron de Beuil , qui assure en quelque sorte la transition nécessaire entre les deux périodes. Sa fin tragique, en 1621, condamné pour « infidélité, félonie, rébellions et machinations » , marque une véritable rupture dans l’histoire de la noblesse locale.
Ses nouveaux représentants sont fidélisés par le souverain Savoyard qui les comble d’honneurs. Ils sont eux-mêmes attentifs à les recevoir et les faire valoir dans une société du paraître baroque. En compensation, ils jouent le rôle de relais local du pouvoir du duc de Savoie, tout en faisant valoir leurs propres avantages. Noblesse de service, il est temps pour elle, à la fin du XVIIe siècle, de s’approprier les anciens droits féodaux, et pour de nombreux seigneurs, d’acquérir un titre nobiliaire.
Les nouvelles inféodations du XVIIe siècle
La relation privilégiée entre les Communautés et le souverain connaît effectivement une première faille à la fin du XVIIe siècle. À cette époque, le décès du duc de Savoie Charles Emmanuel II laisse une régence difficile à la duchesse Madame Royale. Celle-ci préserve autant qu’elle le peut l’autorité du jeune Victor Amédée II, le dernier duc de la lignée. Il accéda quelques années plus tard au titre tant convoité de roi, de Sicile tout d’abord (1713), remplacé par celui, moins prestigieux, de Sardaigne (1720).
La reprise en main des structures de l’État, alors même que la Savoie entre en guerre contre la France, nécessite un effort tout particulier du Fisc. C’est alors que les Communautés sont sommées de rembourser d’importants arriérés d’impôts (les arrérages) provenant du rattrapage d’une monnaie dévalorisée depuis la fin du XIVe siècle, quand avait été fixée la taxe de participation de chacune des communes… Les villages du Comté de Nice devenaient ainsi débiteurs du Fisc ducal pour plusieurs milliers de livres, généralement entre 12 et 25 000 selon l’importance du lieu concédé .
Ne pouvant généralement pas rassembler une telle somme, malgré les tentatives d’emprunts effectuées auprès des notables locaux, elles perdaient le bénéfice de leurs seigneuries. Celles-ci étaient proposées à des personnalités argentées qui attendaient l’opportunité d’accéder à la noblesse et de se voir titrées.
Rappelons également que cette classe, issue du monde des marchands, ne dérogeait pas par leur métier dans les états de Savoie contrairement à ce qui se passait dans le royaume de France. Ce qui laissait libre cours aux ambitions de toute personne ayant atteint l’aisance sociale et financière.
Quelques exemples suffiront à dresser le portrait de cette nouvelle classe seigneuriale, très soucieuse de se voir doter des meilleurs titres.
C’est le cas d’Antoine GARAGNO, qui obtenait, le 29 octobre 1680, le fief de Roquebillière. Auguste MUSSO rappelle qu’à sa mort, en 1700, « la population se souleva » pour éviter que le fief ne soit remis au fils du seigneur défunt. Seule l’intervention directe et personnelle de l’Intendant pu ramener le calme au village. Ce n’est finalement que le 22 septembre 1722 que Jean-Baptiste GARAGNO rachetait le fief de Roquebillière pour 5 500 francs, et y installait immédiatement ses officiers : juge ordinaire, baile et huissier. La seigneurie Moderne s’installait.
Ou encore le Comte Jérôme-Marcel GUBERNATIS , qui tente d’acquérir la seigneurie de Saint-Martin-Lantosque, en 1684, contre le paiement de 12 000 livres, mais pour lequel la réaction de la Communauté réussit à éloigner le danger de l’inféodation….
Ce sont les RIBOTTI du Valdeblore , lignage issu du médecin Jean, originaire de Pierlas, dont l’arrière-petit fils, dénommé également Jean, docteur en médecine et philosophie, professeur d’anatomie à l’hôpital de Milan, qui, en 1699, entre en possession de 13 fiefs, entre Roya et Tinée, dont Valdeblore, Venanson, Utelle et Lantosque. Pour ce faire, il n’hésite pas à débourser près de 160 000 livres, somme colossale pour l’époque. Cela même s’il revend assez rapidement certains de ces fiefs.
Ailleurs encore, c’était la communauté d’Entraunes qui cherchait à se libérer de ce danger par le paiement des arriérés d’impôts, ce qu’elle réussit à obtenir finalement le 19 mai 1702…
Cette présence d’un vassal direct du Roi, portant le titre de comte du village duquel il tenait sa toute nouvelle seigneurie, aurait indubitablement aggravé la charge sociale pesant sur les habitants du lieu, même si « le feudataire ne retirait de son fief que le titre nobiliaire associé au nom de la Communauté … [et] prétendait à la préséance, exigeait les honneurs ». Les symboles que ces prérogatives représentaient offensaient la mémoire des Anciens qui avaient su conserver des privilèges durement gagnés : il était le premier à entrer dans l’église, y possédait un siège armorié… Des droits de préséance qu’il était difficile de négliger.
Une dernière relique de cette seigneurie « nouvelle forme » a perduré jusqu’à nos jours. Certaines communautés se sont appropriées les armoiries de ces familles comtales du XVIIIe siècle, telles Roquebillière ou Belvédère.
Une seigneurie qui perdure : la seigneurie ecclésiastique
La seigneurie ecclésiastique s’implante tôt dans la Vésubie, et c’est principalement grâce à elle que nous possédons les premiers documents du XIe siècle. Ce sont les fameuses donations-restitutions de la famille ROSTAING, qui font apparaître à la fois la « généalogie » des seigneurs laïcs, leur implantation spatiale dans le Haut-Pays et le nouveau partenaire avec lequel il faut désormais compter : l’Église.
Celle-ci récupère en cette occasion les dîmes qu’elle ne percevait plus depuis longtemps (si elles les ont jamais perçues) sur le Haut Pays et qui avaient été « spoliées » par l’aristocratie laïque.
Il existe en fait plusieurs types de seigneuries ecclésiastiques présentes dans le Haut Pays Niçois. La première semble être celle issue des possessions des grands monastères, Pedona (Borgo San Dalmazzo), Saint-Victor de Marseille, Saint-Honorat de Lérins, et Saint-Pons de Nice. Toutes ne sont pas présentes en Vésubie. Il faut leur ajouter, dans un deuxième temps, la présence de la seigneurie de l’évêque de Nice et de son Chapitre cathédral. Il faut enfin considérer celle des ordres religio-militaires, et principalement celui des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, et ceux des Sanctuaires. D’autres formes, plus proches du fidèle, peuvent enfin être relevées avec les prieurés et les cures d’une part, et les hôpitaux d’autre part, tenus par les confréries de Pénitents, qui possèdent toutes les attributs de la seigneurie.
L’emprise des grands monastères
La Vésubie est divisée en deux zones d’influence. L’une, provenant de la côte avec l’emprise de Saint-Pons sur Lantosque, Gordolon, l’autre ultramontaine, avec les possessions de l’abbaye piémontaise de Pedona.
Débutons par l’emprise du temporel de Saint-Pons. Le monastère aurait été fondé à la fin du VIIIe siècle, si l’on en croit Charles-Alexandre FIGHIERA , qui fait lui-même référence à GIOFFREDO (abbé de Saint-Pons en 1688 et jusqu’en 1692, année de sa mort). Au XIe siècle, il possède déjà un important patrimoine, qu’il constitue vraisemblablement lors de ce même siècle. Après une période d’éclipse, la Réforme de l’Église lui redonne les moyens de s’implanter sur un vaste territoire, à la suite de multiples donations dont il est l’objet de la part des seigneurs laïcs. Il détient ainsi les paroisses d’Aspremont, de l’Escarène, de Falicon, de Sainte-Réparate et de San Jaume à Nice. Il reçoit aussi la seigneurie des fiefs de Châteauneuf, de Gordolon et de Saint-Blaise, en plus de l’Escarène et de Falicon. Ses moines, qui ne furent jamais plus de 15, pouvaient ainsi se considérer comme de véritables seigneurs. Pourtant, à la fin du XIVe siècle, elle est placée sous la dépendance de Saint-Victor de Marseille, la grande abbaye bénédictine provençale. Son premier abbé connu, Guillaume de Berre, rend hommage à Charles Ier en 1261, et lors de cette cérémonie, prête serment pour son fief de Gordolon.
Retrouver la carte sur le fichier pdf
Son successeur nous rapproche encore plus de la Vésubie, puisqu’il s’agit de Jean TOURNEFORT, originaire de la famille des chevaliers de Lantosque. Il dirige l’abbaye de 1362 à 1365, avant de pourvoir aux destinées de l’abbaye de Lérins. Cette promotion nous laisse penser qu’il s’agit-là d’un personnage de tout premier plan.
À la fin XIVe siècle, Gordolon est l’objet d’un réaffouagement, sorte de recensement nécessaire pour définir le nombre de foyers fiscaux, qui seuls paient l’impôt. Nous apprenons ainsi que l’ancien village est réoccupé, qu’il dépend toujours de la seigneurie ecclésiastique et qu’y sont déclarés 8 feux fiscaux. Le prieur commendataire prête l’hommage-lige au gouverneur en 1496 pour ce lieu et pour son territoire, possédant les mixte et mère empire et basse juridiction. Ce seigneur ecclésiastique est alors devenu le seul feudataire de la vallée.
L’abbaye venait d’être mise en commende, en 1473. Rappelons que la commende est un ensemble de revenus attribué directement à un prélat afin de constituer sa prébende et lui assurer un rang social souvent important. En 1525, le nouvel abbé, Honoré Ier MARTELLI, est également originaire de Lantosque, et si l’on en croit GIOFFREDO, fut auparavant prieur de Loda.
C’est enfin aux GRIMALDI qu’il faut revenir. Ils tiennent déjà le château de Belvédère au milieu du XIVe siècle , mais aussi l’abbaye de Saint-Pons, avec Dom Guillaume qui en est l’abbé en 1463. Gordolon restait une des dépendances importantes du monastère à la même période. Château et prieuré offrent une conjonction territoriale et chronologique intéressante dont les bénéfices reviennent à cette famille des GRIMALDI. La même famille tire encore de nombreux revenus de notre vallée mais aussi dans sa proximité immédiate, au milieu du XVIe siècle, quand Dom Louis est nommé prieur commendataire de Saint-Dalmas et de la Bolline Valdeblore. Cette qualité de prieur-commendataire ne l’oblige pas à résider sur place, ce qui lui permet d’attribuer cette fonction à quelques desservants de sa clientèle. Il détient aussi le prieurat de Saint-Véran d’Utelle, de Saint-Antoine de Levens et de Saint-Jean-Baptiste de Villars, puis devient abbé de Saint-Pons en 1590.
Durant toute la période considérée, le prieuré de Gordolon fut mis en commende et forma le bénéfice de l’abbaye et de ses moines, et cela même après la disparition définitive du castrum du lieu et l’appropriation de son territoire par les villages voisins.
La seconde abbaye importante est celle de Pedona, aujourd’hui Borgo San Dalmazzo, qui existe déjà au début du Xe siècle, et a sans doute été fondée au VIIIe siècle. Elle est reconstruite au Xe siècle , mais nous ne connaissons pas l’étendue de ses possessions. Ce n’est qu’au XIIIe siècle qu’il est fait référence à ses dépendances, par la fameuse bulle de 1246 .
Ces possessions s’étendent transversalement depuis la plaine padane jusqu’à la Provence, en passant par les cols de Fenestres et de Tende. Paradoxalement, c’est au moment où nous pouvons lire avec le plus de précision l’étendue du domaine de l’abbaye de Pedona qu’il lui échappe au profit des seigneuries locales et laïques.
Le temps des grandes abbayes fut incontestablement les XIe-XIIIe siècles. Elles furent bénéficiaires de la grande réforme bénédictine qui permit le renouveau de l’Église. Ce mouvement leur permis d’arrondir leur patrimoine foncier au détriment des seigneurs locaux, soutenus en cela par les comtes qui y voyaient, en plus d’une opportunité de rasséréner leur âme, un moyen d’affaiblir une aristocratie bouillonnante et insoumise. L’aristocratie su pourtant rapidement tirer profit de ces établissements, en plaçant certains de ses membres à la tête des institutions, ce qui rendait tangible le risque d’une « patrimonialisation » de leur temporel. Mais après le XIIIe siècle, les temps changèrent…
Les Hospitaliers
Une autre seigneurie importante présente dans la Vésubie fut celle des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Nous les rencontrons à Roquebillière dès 1141, quand l’évêque Pierre Ier de Nice leur remet la seigneurie de l’église Saint-Michel.
Cet ordre religio-militaire est en fait créé en 1109, mais ne reçoit la vocation militaire qu’après 1129, et ne devient réellement « guerrier » qu’avec les statuts promulgués en 1182 . L’attribution des biens de Roquebillière participait à l’origine au seul entretien des pèlerins.
Jean-Claude POTEUR pense que les Hospitaliers ont pu être introduits en Vésubie « sur incitation » du Comte de Provence au moment où celui-ci s’assurait une présence plus continue dans cette vallée périphérique. Le rôle des Hospitaliers maintenait ainsi un lien ténu avec l’autorité comtale. Il faut sans doute considérer ce lien comme un des éléments sur lequel s’appuya le comte au moment de sa reprise en main, après la militarisation de l’Ordre, amenant la soumission définitive de la Vésubie lors du premier tiers du XIIIe siècle. Dès lors, et jusqu’au XVIIe siècle, les Hospitaliers furent présents en Vésubie grâce à leur maison de Roquebillière. Joseph Antoine DURBEC nous présente une étude détaillée de leurs biens inventoriés à l’occasion d’une enquête commandée par le pape Benoît XII, en 1338 . Cette maison faisait partie du bailliage de Nice, avec le Broc et Biot. S’y ajoutaient des biens répartis dans le Haut Pays à Breil, Levens, Lucéram, Sospel, Tende, et sans doute à Saorge.
À Roquebillière, les Hospitaliers possédaient l’église de Saint-Michel dite du Gast et une maison qui devait lui être adjointe. Leurs biens concernaient 16 ha de terres arrosables (pour 200 setiers de récolte soit un peu plus de 8 tonnes de céréales, mais un rapport de 4 pour 1 de rendement - ce qui implique de conserver une part importante de semence), et 2 solchas de prés (pour 20 charges de foin, soit plus d’1 tonne ½). Ils prélevaient la dîme des blés sur l’ensemble du territoire (plus de 6 tonnes de céréales), celle des vins (l’équivalent de 190 hl), celle des agneaux (5 livres en monnaie). Ils possédaient également un moulin, que l’on peut imaginer à proximité de l’église Saint-Michel, et imposaient encore, mi-XIVe siècle, les personnes sujettes pour 2 livres ½, en plus des différentes oblations dont l’église était le récipiendaire (2 livres 10 sous)….
Les Hospitaliers de la maison de Roquebillière ne devaient pas demeurer à l’année sur le site. Ils géraient pourtant l’ensemble de la seigneurie avec régularité grâce à quelques domestiques permanents : un serviteur, un bouvier chargé du troupeau de l’Ordre, du moins durant la période des pâturages, un clerc qui desservait l’église et un messager qui assurait le lien avec la maison mère de Nice. Tous étaient habillés, nourris et recevaient un salaire pour leur travail au quotidien qui assurait le maintien de la Maison.
DURBEC rappelle enfin le rôle caritatif des Hospitaliers, qui se devaient de pratiquer l’aumône trois fois par semaine « de la saint Michel à la saint Jean-Baptiste de juin » et entretenaient l’église et leurs dépendances, véritables acteurs économiques du lieu, dans un rapport inégal de prélèvements - compensations (par l’aumône mais aussi par l’entretien des édifices, église, maisons, moulin et hospice…) rendant moins tendues les relations avec la population locale.
Les Hospitaliers perdirent leur maison de Roquebillière au milieu du XVIIe siècle au profit de la Communauté qui réussit à s’en attribuer la seigneurie. Notons toutefois que depuis au moins le XVe siècle, celle-ci était entre les mains de prieurs d’ascendance locale, telle que Jean JUGLARIS (1418, 1424), Monet ROGIERI (1486, 1535) ou Nicolas ROGERI (1574-1621). Cet indice se retrouvera dans d’autres situations.
Malgré cet état de fait, les Hospitaliers revendiquèrent une dernière fois leur ancien prieuré de Roquebillière, en novembre 1779 . C’est Dom Joseph GABASTILLE de OLLIVARIS qui enjoint au prêtre de Saint-Michel, Claude ODDOART, de se retirer pour laisser place au titulaire qu’il venait de nommer. D’après Auguste MUSSO, les documents fournis par le prêtre (compromis de 1486 entre la Communauté et le prieur, recours du prieur Horace LAURENTI auprès du pape Innocent X en 1647…) et d’autres non-cités lui permirent de se faire droit. C’est ainsi que disparaissaient les Hospitaliers de Roquebillière, suivant en cela l’évolution déjà constatée pour les autres seigneuries ecclésiastiques.
La survie des seigneuries ecclésiastiques
La troisième grande seigneurie ecclésiastique de la Vésubie est celle de la Madone de Fenestres. Possession présumée de Pedona, elle est déjà liée à la paroisse de Saint-Martin en 1287. Bien qu’ayant été adjointe en commende au Chapitre cathédrale de Nice dès le milieu du XIVe siècle, celle-ci est tenue par un desservant résidant, et ce, jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Mais elle est également tenue par des membres de la notabilité locale dès le siècle précédent, ce qui ne se démentie plus jusqu’au XIXe siècle. C’est d’ailleurs cette caractéristique qui permet d’expliquer la pérennisation de la seigneurie ecclésiastique en Vésubie, les desservants étant très attachés à la conservation des biens et revenus leur afférant, gages de leur niveau de vie et de l’emprise économique qu’ils pouvaient réellement avoir sur la Communauté.
En fait, dès le XVIe siècle, et progressivement, le prêtre desservant du village, le curé, devient le véritable seigneur du lieu, tenant entre ses mains les droits éminents d’un patrimoine foncier fondamental à la survie des habitants. La seigneurie de la Madone tenait encore, mi-XVIIIe siècle, près de 500 parcelles de terres dont elle retirait un cens important ; le prêtre était alors devenu un simple rentier, mais le tout premier personnage du village.
Des seigneuries ecclésiastiques pérennes érigées en modèle de gestion
Nous pouvons conclure qu’il n’y a pas eu de véritable « sécularisation » des seigneuries ecclésiastiques et qu’elles traversent l’époque Moderne en conservant l’essentiel de leurs attributs. Elles connaissent néanmoins des changements plus profonds dans leur mode de gestion, car elles deviennent de simples seigneuries foncières dont les prélèvements s’apparentent bien plus à des formes de rentes. Issues des grandes seigneuries médiévales, tenues par les grandes familles « féodales », elles sont tombées entre les mains de la notabilité locale qui réussit quasiment à les intégrer dans leurs propres patrimoines. Le danger d’une véritable appropriation de la part de certaines familles réapparaît régulièrement dans les documents. Elles sont devenues l’enjeu des même luttes de pouvoir, inhérentes à la gestion collective des Communautés. Cette caractéristique devient évidente lors des confrontations qui ont lieu à l’occasion de la nomination au prieurat de ces seigneuries qui en assure la pérennité et l’équilibre nécessaire à une gestion « honnête » de leur patrimoine foncier (leur temporel). Elles sont devenues le reflet de la société des Communautés.
Bien plus que cela encore, cette « notabilisation » de la société des villages du Haut Comté de Nice se retrouve dans d’autres aspects encore de la vie quotidienne. Elles ont donné le modèle pour d’autres organismes de gestion collective à caractère caritatif, qui ne pouvaient être séparés du sentiment religieux et baroque qui prévalait dans la société. Ce sont les confréries, les chapellenies et les hôpitaux, qui se voient dotés progressivement, à la suite du ou des fondateurs, d’un patrimoine foncier procurant les revenus nécessaires à leur fonctionnement. Nous pouvons prendre l’exemple de l’hôpital de la Sainte-Croix de Lantosque , qui reçoit, entre autres, le 24 décembre 1716, une donation de la part de la dame Louisette DALLO(NA) qui cède une terre emphytéotique au quartier Pical, extra-dotale, avec, comme il se doit, l’accord de son mari. Cette terre, comme toutes celles qui sont attribuées à cet hôpital, possède tous les attributs de la seigneurie. Ce n’est en fait que la propriété éminente qui est transférée. L’exploitant est un certain Jean-Baptiste MAURIN, qui doit désormais le cens à l’Hôpital géré par la confrérie des Pénitents blancs du lieu représentée par son recteur Jean Thomas AUDA pour une estimation fixée à 35 livres. La terre est libre de droits sinon le trézain qui doit être payer lors des mutations, le droit de prélation (à 5 sous en dessous du prix estimé normal) et le cens de 3 livres ½ annuelles que recevra la confrérie pour l’attribuer à la gestion de l’hôpital. Cette terre possède bien toutes les caractéristiques des biens seigneuriaux.
Les exemples de ce genre se retrouvent par centaine dans les villages du Haut Pays aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ils démontrent que la qualité de la terre ne se perd généralement pas, et que la Communauté, sous l’une ou l’autre de ses formes (comme la confrérie par exemple), peut effectivement être considérée comme un véritable seigneur en ce qui concerne la gestion du patrimoine foncier.
Conclusion
En conclusion, que peut-on dire de l’histoire des seigneurs de la Vésubie, entre le XIe et le XVIIIe siècle ? Tout d’abord que notre vallée a sans aucun doute connu les temps féodaux, ceux de l’éclatement du pouvoir entre de multiples petits seigneurs. Et cela même s’ils ne nous apparaissent plus qu’en « négatif », au moment où les quelques grandes familles, bénéficiaires des appropriations des IXe-Xe siècles, sont sur le déclin. Un déclin qui se prolonge durant trois siècles, pendant lesquels nous avons constaté l’âpre concurrence qui se joue entre les chevaliers, les Communautés et le Comte. Si les premiers peuvent être considérés comme issus d’une forme régressive du pouvoir seigneurial, les deux derniers sont appelés à une longue existence. Le Comte par la mise en place de l’Etat, exprime pleinement son pouvoir à la fin du XVIIe siècle comme au siècle suivant, époque qui peut être aussi considérée comme le temps de la mise au pas définitive des Communautés. Celles-ci se sont posées très rapidement (dès le XIIIe siècle) en tant qu’interlocutrices privilégiées du Comte puis du Duc, mais ont dû résister, tant bien que mal, aux forces centrifuges conjuguées de l’État et de leurs propres groupes de notables. Ce fragile équilibre assure la paix sociale grâce à une dialectique complexe de rapports familiaux pour l’attribution et le partage des biens économiques communaux. Ce sont ces mêmes lignages, animés par certains de leurs membres, qu’ils soient laïcs ou ecclésiastiques, qui ont finalement pu s’approprier les anciens domaines seigneuriaux issus du Moyen Age. C’est en cela que l’époque Moderne peut être considérée comme le véritable temps des notables.
In Patrimoine du Haut Pays n° 9, pp. 172-194
Commander l’ouvrage sur le site de l’AMONT
Les seigneurs de la Vésubie en pdf
Commentaires
-

1 Comment trouver un vrai marabout, envoûtement amoureux, rituel de retour affectif, faire revenir son ex, comment récupérer son mari ou sa femme, voyance en ligne, voyance sérieuse sans support, magie blanche d'amour, marabout amour durable, je cherche un Le 22/03/2024
Si votre relation est sur le point de prendre fin ou si votre proche s’éloigne ou s’est éloigné de vous. Vous avez des problèmes familiaux ? Je peux vous aider à le ramener. Ou Parfois, c’est vous qui devez rompre avec votre partenaire juste à cause de sa possessivité, de sa nature dominatrice ou pour toute autre raison. Je peux en effectuer une pour vous, Sort fort et puissant.
Retour de l'être aimé rapide-Comment faire revenir l'être aimé très rapidement?
Vous souhaitez reconquérir un amour perdu?
Vous souhaitez séduire une personne qui vous plaît?
Vous souhaitez rencontrer une personne qui vous rendra heureux/se?
Vous souhaitez en finir avec la tristesse et la solitude affective?
Pour arriver à trouver et reconquérir l'amour la magie blanche vous donne la solution pour satisfaire toutes vos envies.
Il vous est donc possible d'effectuer des rituels pour :
• Récupérer un amour perdu
• Protéger votre couple
• Faire à ce que la fidélité règne dans votre couple
• Pour être plus performant sur le plan sexuel
Etc...
WhatsApp: +229 9778 8791
E-mail: contact.maitreamangnon@yahoo.com
NB: Je vous donne la preuve que mon travail marche avant tout engagement.
Ajouter un commentaire